cinéma
-
Fonds
Auteurs
Titre
Mots clefs, catégories, couleurs
Type
-
Ciné ITS : « Il fare politica, chronique de la Toscane rouge (1982-2004)
Actualités, Ciné-club, cinéma, Italie, Rencontres, Séminaires, VIDEO
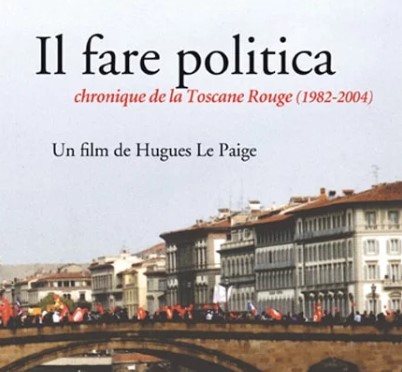
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°804 – 23 novembre 1978
Antilles, Armée, Autogestion, Chômage, cinéma, Culture, Emploi, Femmes, Forum de l'autogestion, Immigration, Intérimaires, Jeunes, Licenciements, Michel Mousel, Militarisation, Nucléaire, Pisani, Social, Travail
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°802 – 9 novembre 1978
Allemagne, Antilles, Autogestion, CFDT, CGT, cinéma, Culture, Économie, Femmes, Forum de l'autogestion, International, Iran, Larzac, Marins, Michel Mousel, Parti, Paysans, PSU 60-90, Social, Syndicats, Théâtre
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°801 – 2 novembre 1978
Agriculture, Antilles, Autogestion, CGT, cinéma, convergence autogestionnaire, Culture, Démocratie, FGA, Forum de l'autogestion, Histoire du PSU, International, Larzac, Lip, Luttes sociales, PSU 60-90, Salariés agricoles, Social, Soisson, Syndicats, Travail
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°793 – 7 septembre 1978
accidents du travail, Afrique, Boussac, Camp David, cinéma, Culture, Économie, Famine, Homo faber, International, Iran, Livres, Plan Barre, Production, Social, sondage, Tchad, Travail
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°786 – 26 mai 1978
Afrique, Armée, Autogestion, Barre, Cannes, cinéma, communistes, Culture, Désarmement, Fête du psu, Forum de l'autogestion, Grève, International, Marée noire, Nanterre, Prison, Psychologie, Renault Flins, Social, Télévision, Zaïre
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°783 – 27 avril 1978
austérité, Autogestion, Bombe, cinéma, communistes, Culture, Droit de vote des étrangers, Économie, Edmond Maire, Espagne, Fête du psu, Gauche, Giscard d’Estaing, Immigration, International, Justice, Michel Warcholak, Nucléaire, Portugal, Syndicats, Tchad, Télévision, unité de la gauche
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°781 – 6 avril 1978
Algérie, antiparlementarisme, Argentine, CFDT, CGT, cinéma, Cjili, communistes, Culture, Démocratie, DPN, Espagne, Gauche, International, Italie, Liban, Licenciements, Parti, Pompidou, PSU 60-90, Sidérurgie, Social, Socialistes, Syndicats, Télévision
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°779 – 23 mars 1978
Autogestion, Bretagne, cinéma, Culture, Écologie, Élections, Elections législatives, Emploi, Femmes, Festival de Bourges, front autogestionnaire, Gauche, Hélène Parmelin, International, Italie, Jeunes, musique, Orphelins, Proche-Orient, Régions, Social, Télévision
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°777 – 9 mars 1978
Autogestion, Brésil, cinéma, Culture, Écologie, Élections, Emploi, FNSEA, front autogestionnaire, Gauche, International, Morlaix, Patronat, politique étrangère, Régions, ruralité, Social, Télévision, Théâtre
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°776 – 2 mars 1978
Autogestion, CFDT, cinéma, Culture, DOM-TOM, école, Économie, élections, Enseignement, Etats-Unis, front autogestionnaire, Homosexualité, Inégaités, Michel Rolant, Parti Communiste, Parti Socialiste, Serbie, Social, Socialisme, Syndicats, Télévision
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°773 – 9 février 1978
Autogestion, cinéma, Culture, droits des femmes, Écologie, éducation, Enseignement, Femmes, International, Italie, non-violence, Parlement, Politique, Portugal, PTT, Social, Socialisme, Tchad, Théâtre, Travail, Travailleuses
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°771 – 26 janvier 1978
Autogestion, CFDT, cinéma, Culture, Droite, front autogestionnaire, Grèves, Nucléaire, Parlement, Politique, PTT, Social, Syndicats, Télévision, Théâtre, Travail, Violence
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°770 – 19 janvier 1978
Afrique, Angela Davis, Cadre de vie, Carter, CFDT, CGT, Chine, cinéma, Culture, Extrême gauche, Impérialisme, International, Italie, Luttes, Parti, Parti Communiste, Politique, PSU 60-90, Raymond Barre, Syndicats, Télévision, Théâtre, Union de la gauche, USA
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°769 – 12 janvier 1978
Afrique, Algérie, Autogestion, cinéma, Culture, Djibouti, Femmes, front autogestionnaire, International, Nucléaire, Parti Communiste, Parti Socialiste, Patronat, Programme commun, Sidérurgie, Social, Télévision, Travail, Viol
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°768 – 5 janvier 1978
Autogestion, Cambodge, cinéma, Culture, Écologie, Giscard, Immigration, International, Michel Mousel, Michelin, Nation, Politique, SAHARA, Social, Télévision, Travail, travailleurs immigrés, Vietnam
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°766 – 14 décembre 1977
Autogestion, Cadre de vie, cinéma, Consommation, Culture, école, Écologie, Économie, EDF, énergie, Enseignement, Justice, Logement, marxiste chrétien, Nationalisation, Nucléaire, Politique, Portugal, SNCF, Social, Syndicats, Télévision, Transports, Tribune Socialiste
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°763 – 24 novembre 1977
Affaire Croissant, Afrique, Barre, Bernard Ravenel, Chômage, cinéma, Culture, Écologie, Emploi, Femmes, Forêt, Giscard d’Estaing, Grève, Inflation, International, Jérusalem, Justice, Patronat, Police, Politique, Sadate, Sécurité, Social, Sport, Théâtre, Travail
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°761 – 10 novembre 1977
Autogestion, Budget, Cadre de vie, Chypre, cinéma, Consommation, Culture, Démocratie, Djibouti, Économie, Inflation, International, Irlande, Lip, Militantisme, Parti, Parti Socialiste, Patronat, PCF-PSU, Politique, Social, Syndicats, Télévision, vie quotdienne
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°753 – 15 septembre 1977
cinéma, Culture, école, Écologie, Enseignement, Espagne, Gauche, Giscard d’Estaing, Guyane, International, Jean-Claude Carrière, Luttes ouvrières, Manufrance, Montefibre, Politique, Séguy-Marie, Social, Télévision, Travail
-
Olivier Barrot, Jean-Pierre Jeancolas, Gérard Lefevre
Cinéma service pubic
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°736 – 31 mars 1977
Armée, Autogestion, Bande dessinée, Banque, BNP, cinéma, Classes sociales, Comités de soldats, Culture, Économie, Gauche, Giscard d’Estaing, Grande-Bretagne, International, Luttes des classes, Municipales, Politique, Social, Socialisme, Télévision, URSS, Uruguay
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°708 – 1er juillet 1976
Afrique, Afrique australe, Autogestion, Chômage, Chrétiens, ci, cinéma, Culture, Emploi, énergies, Gauche, International, Italie, JOC, Luttes, Nucléaire, Portugal, Social, Travail
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°706 – 18 juin 1976
Autogestion, Cadre de vie, CFDT, cinéma, Culture, Femmes, Fête du psu, Gauche, Grève, International, Italie, Justice, Palestine, Parti, Politique, Révolution, Socialisme, Syndicats, Travail, Unité populaire, Ville / Urbanisme
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°703 – 28 mai 1976
Agriculture, Autogestion, Cannes, CFDT, cinéma, Cisjordanie, Culture, école, Économie, Entreprise, Étudiants/UNEF, Grèce, International, Liban, Logement, Luttes, Moyen Orient, Politique, Syndicats, Travail, Turquie, Université, USA, Ville / Urbanisme
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°701 – 13 mai 1976
Autogestion, Banque, CFDT, cinéma, Constitution, Culture, Économie, Femmes, gauhce, International, Italie, Parti, Politique, Presse, Socialisme, Syndicats
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°699 – 29 avril 1976
Catalogne, cinéma, Culture, Espagne, Femmes, Fro, Front populaire, Gauche Révolutionnaire, Histoire, International, Révolution, sectarisme, SFIO, Syndicats, Vie Quotidienne
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°696 – 3 avril 1976
Agriculture, Amérique Latine, Argentine, Armée, cinéma, Consommation, Crêches, Culture, Espagne, Fascisme, Femmes, International, Peugeot, SNCF, Social, Télévision, Transports, Travail
-
Collection de Tribune Socialiste
Tribune Socialiste n°695 – 27 mars 1976
Amérique Latine, Argentine, Armée, cinéma, Culture, Espagne, Étudiants/UNEF, Femmes, Fonction publique, Histoire du PSU, International, Politique, PSU 60-90, SNCF, Social, Syndicats, Transports
-
Un film de Serguei Mikaelian
cinéma, Culture, Répression, Socialisme, URSS - Débats politiques