Travail
-
Fonds
Auteurs
Titre
Mots clefs, catégories, couleurs
Type
-
À propos de LIP
Autogestion, CFDT, Charles Piaget, Lip, Social, Socialisme, Syndicats, Travail

-
En images : la marche lip de 1973
Autogestion, CFDT, Charles Piaget, Histoire du PSU, Lip, Social, Travail
-
Quelle place pour le travail aujourd’hui ?

-
Marie-Claire Cailletaud, Mathieu Ciserane, Barbara Gomes, Julien Lusson
Que disent les mobilisations sur le travail ?
-
Myriam Chatot, Alain Obadia, Rachel Silvera
Crise sanitaire et inégalité de genre
-
Gérard Duménil, Jean-Luc Molins
Transformation du travail : compétences, précarité, précarisation
classes sociales, Duménil/gérard, Molins/Jean-Luc, Rencontres, Séminaires, Salariat, Travail, Travail
-
Le travail du care : évolutions et problèmes
-
Que sont et que font les cadres aujourd’hui ?
-
Les cadres aujourd’hui
Classes sociales, Organisation du travail, Rencontres, Séminaires, Syndicats, Temps de travail, Travail
-
Fin du travail ou plein emploi ? (1)
Chômage, Économie, Emploi, Rencontres, Séminaires, Revenu universel, Travail
-
Fin du travail ou plein emploi ? (2)
Chômage, Économie, Pauvreté, Productivité, Rencontres, Séminaires, Temps de travail, Travail
-
Temps de travail et temps sociaux
-
Le revenu universel – Baptiste Mylondo
Allocations, Économie, Économie, Emploi, Impôt, Rencontres, Séminaires, Social, Travail
-
Le revenu universel – Stéphanie Treillet
Économie, Économie, Emploi, Femmes, Impôt, Rencontres, Séminaires, Social, Temps de travail, Travail
-
Frédéric Bricnet, Patrick Cingolani, Joël Decaillon, Dominique Gillier, Odile Merckling, Daniel Richter, Yves Sinigaglia
Les reconfigurations du travail – Débats ITS N°5
Capitalisme, lien social, Organisation du travail, précarités, Publications, Travail

-
Le temps : enjeu social
Emploi, lien social, loisirs, Organisation du travail, Rencontres, Séminaires, Travail
-
La continuité des temps sociaux
Emploi, lien social, loisirs, Organisation du travail, Rencontres, Séminaires, Travail
-
Jean-Yves Bonnefond, Franck Daout, Daniel Richter
Changer le travail ! quelles possibilités ?
Emploi, lien social, Rencontres, Séminaires, Santé, Social, Syndicats, Travail
-
Loi Travail, égalité femmes-hommes
Mixité, Organisation du travail, parité, Rencontres, Séminaires, Syndicats, Travail
-
Claude Neuschwander, Michel Perraud, Henri Rouilleault, Jacques Sauvageot
Faut-il changer le code du travail ?
Agenda, Emploi, Organisation du travail, Politique Économique, Travail
-
Michèle Descolonges, Dominique Gillier
Les transformations des métiers
Économie, Enseignement, Politique industrielle, Rencontres, Séminaires, Social, Syndicats, Travail
-
Travail féminin : les dommages de la précarité
-
Quelles stratégies syndicales face à la précarisation de l’emploi et du travail ?
action syndicale, Organisation du travail, Précarité, Syndicats, Travail
-
Pauvreté laborieuse, fruit de la précarité
-
Indépendance, précarités et société salariale
-
force et fragilité du lien social
lien social, Rencontres, Séminaires, Travail, VIDEO
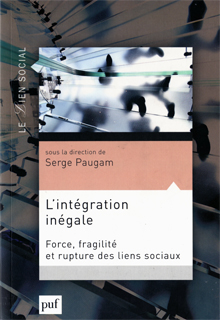
-
Management et précarité subjective organisée
lien social, Management, Politique Économique, Précarité, Syndicats, Travail
-
Sophie Beroud, Danièle Linhart
Précarités et mouvements syndicaux
lien social, Mouvements sociaux, Politique Économique, Syndicats, Travail
-
Hélène Crouzillat, Margaret Maruani, Matermittentes
Les femmes dans le travail : inégalités et précarités
Économie, Femmes, Ingégalité, lien social, Précarité, Travail, Travail
-
Le travail à l’épreuve de l’utopie
lien social, Rencontres, Séminaires, Travail, Travail, Utopie