Temps de travail
-
Fonds
Auteurs
Titre
Mots clefs, catégories, couleurs
Type
-
Les cadres aujourd’hui
Classes sociales, Organisation du travail, Rencontres, Séminaires, Syndicats, Temps de travail, Travail
-
Fin du travail ou plein emploi ? (2)
Chômage, Économie, Pauvreté, Productivité, Rencontres, Séminaires, Temps de travail, Travail
-
Temps de travail et temps sociaux
-
Eric Beynel, Sophie Binet, Dominique Hénon, Michel Lallement, Chantal Nicole-Drancourt, Philippe Tancelin
La transformation des temps – Débats de l’ITS N°6
Flexibilité, Précarisation, Publications, stratégie syndicale, Temps de travail
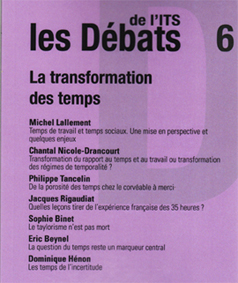
-
Le revenu universel – Stéphanie Treillet
Économie, Économie, Emploi, Femmes, Impôt, Rencontres, Séminaires, Social, Temps de travail, Travail
-
Sylvain Chicote, Gérard Filoche
Bien négocier les 35 heures. Guide pratique (et critique) à l’usage exclusif des salariés
35 heures, Code du travail, Fonds documentaire ITS/PSU, Négociations, Salariés, Temps de travail
-
Philippe Choteau, Agnès Deboulet, Jean-Claude Genet, Patrick Santini
Pour un revenu minimum social garanti
-
Vers une société autogestionnaire
35 heures, Aménagement du territoire, Autogestion, Élections présidentielles, Emploi, Temps de travail, Travail
-
Colloque sur le temps de travail
-
Actualité de l’autogestion
Autogestion, Écologie, Élections présidentielles, marxisme, Pouvoir populaire, Temps de travail
-
Pierre Belleville, Nicolas Géro, Claude Hauser, Michel Mousel, Jean-Yves Sparfel
Le dossier des 35 heures
Politique Économique, Social, stratégie syndicale, Temps de travail, Travail