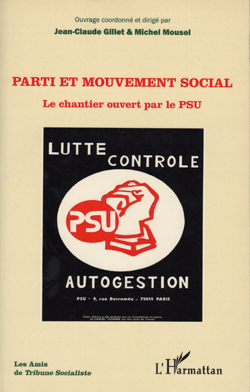Le PSU, des idées pour un socialisme au XXIème siècle ?
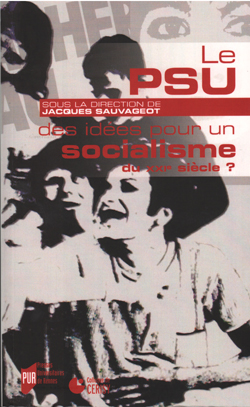
Actes du colloque Centre international de Cerisy -15 et 16 mai 2011
En présentant des réflexions d’acteurs d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que des documents historiques qui permettent d’éclairer ces réflexions, cet ouvrage contribue à revisiter les idées et l’expérience du PSU.
Contributions de Serge Depaquit, Hélène Hatzfeld, Edith Heurgon, Jean-François Kesler, Alain Lipietz, Gus Massiah, Michel Mousel, Maryvonne Prevot, Bernard Ravenel, Michel Rocard, Joël Roman, Lucile Schmid, Emmanuel Terray, Aurélie Trouvé et Patrick Viveret.
Documents : Manuel Bridier, Edouard Depreux, Victor Fay, Marc Heurgon, Bernard Jaumont, Daniel Lenègre, Serge Mallet, Pierre Mendès-France, Michel Mousel, Charles Piaget, Michel Rocard
Éditions Presses Universitaires de Rennes, Janvier 2013 – 416 pages